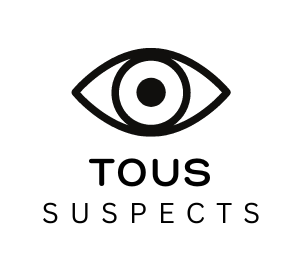Deux de mes collègues – Evan Gershkovich à Moscou et Julian Assange à Londres – croupissent en prison pour avoir fait leur travail : vous tenir informé. La Russie et les États-Unis, sciemment ou non, suivent la stratégie de presse de Joseph Staline. Un exemple typique : la persécution stalinienne du journaliste américain William (Bill) Nathan Oatis dans la Tchécoslovaquie de la guerre froide, qui reflète les poursuites judiciaires contemporaines de mes collègues.
Pour Bill Oatis, comme pour Assange et Gershkovich, le journalisme était moins un métier qu’une vocation. Il a travaillé dans les journaux scolaires dès l’âge de 12 ans et a abandonné ses études universitaires en 1933 pour accepter un emploi dans le journal de sa ville natale, le Marion, Indiana, Leader-Tribune. De là, il a déménagé au Presse associée (PA) bureau dans la capitale de l’État, Indianapolis. (Son rédacteur en chef, Drysdale Brannon, se souvient : « C’était un journaliste factuel et probablement l’homme le plus consciencieux qui ait jamais travaillé dans l’état-major. ») Détourné du journalisme vers l’armée pendant trois ans pendant la Seconde Guerre mondiale, il est retourné à l’armée. PAd’abord à son bureau de presse de New York, puis à Londres et en 1950 à Prague, en Tchécoslovaquie, en tant que chef de bureau.
Le Parti communiste de Tchécoslovaquie, à l’instar des autres États satellites de l’Union soviétique, consolidait son monopole du pouvoir. Le Státní bezpečnost (St.B), auxiliaires du ministère soviétique de la Sécurité de l’État (MGB), avaient expulsé les PAles deux anciens chefs de bureau de pour « reportages non objectifs ». Les correspondants occidentaux restants étaient la cible d’une surveillance rigoureuse.
L’un des premiers articles d’Oatis annonçait que le ministre soviétique des Affaires étrangères Andreï Vychinski était venu secrètement en Tchécoslovaquie pour dicter les lignes directrices de la propagande de Staline au Bureau d’information des partis communistes et ouvriers (Cominform). C’était un scoop. Son scoop suivant fut un rapport selon lequel l’ancien ministre des Affaires étrangères Vladimir Clementis n’avait pas fait défection mais était en état d’arrestation.
En 1951, trois locaux PA des employés ont disparu. Oatis a protesté contre leur arrestation le 20 avril. Trois jours plus tard, il a également été traîné au siège de la police secrète de St.B. Son épreuve ultérieure mêla celle de Kafka Le procès avec celui de Koestler L’obscurité à midi. L’interrogateur l’a harcelé, affamé et humilié, exigeant de savoir pourquoi Oatis ne voulait pas révéler ses sources. Oatis a répondu : « C’est contraire à l’éthique du journalisme. »
Oatis a subi des interrogatoires quotidiens de huit heures. Une grillade s’est poursuivie sans interruption pendant 42 heures. Désireux de mettre fin à ce cauchemar, Oatis a signé des « aveux » qui ne représentaient rien d’autre qu’un aveu selon lequel il avait recueilli des informations qui n’étaient pas officiellement publiées par l’État. C’était Journalisme 101. Pour le régime stalinien de Prague, le journalisme – c’est-à-dire rapporter des faits que le gouvernement préférait cacher – était un crime.
Les procureurs ont inculpé Oatis pour avoir révélé des « secrets d’État », définis à l’article 75 du Code pénal tchécoslovaque du 12 juillet 1950, comme « tout ce qui doit être tenu secret aux personnes non autorisées dans un intérêt important de la République, en particulier dans les domaines politique, militaire ou politique ». intérêt économique. » La peine variait de 10 ans à la perpétuité.
Après 72 jours sans accès consulaire ou juridique, Oatis a été jugé. Le procureur de la République, Josef Urvalek, a déclaré qu’Oatis était « particulièrement dangereux en raison de sa discrétion et de son insistance à obtenir uniquement des informations exactes, correctes et vérifiées ». L’absurdité de condamner, plutôt que de féliciter, un journaliste pour avoir « obtenu uniquement des informations précises, correctes et vérifiées » a échappé au juge président Jaroslav Novak. Oatis et ses trois coaccusés tchécoslovaques, ayant reçu l’assurance que leurs aveux leur épargneraient la prison à vie, ont récité des réponses de zombie qui avaient été répétées au cours des semaines précédentes. (Un enregistrement audio de la procédure, en anglais et en tchèque, est disponible sur le site Internet des Archives nationales tchèques.) Le 4 juillet, le juge Novak a rendu son verdict : coupable ; et peine prononcée — 16 à 20 ans pour les Tchécoslovaques et 10 pour Oatis.
Le Département d’État fulminait le 20 août 1951 : « Selon les lois en vertu desquelles il a été condamné, l’espionnage peut être interprété comme l’acquisition ou la diffusion de toute information qui n’est pas officiellement rendue publique par le gouvernement tchécoslovaque. Ainsi, toutes les routines normales de collecte d’informations d’un journaliste pourraient être décrites comme des « activités d’espionnage ».
La question qui unit Oatis, Gershkovich et Assange n’est pas seulement la poursuite des journalistes pour avoir fait leur travail. C’est une censure de tout ce que l’État estime que nous n’avons pas le droit de savoir.
Le 5 mars 1953, Staline décède dans sa datcha près de Moscou. Sa disparition, combinée à l’installation de nouveaux présidents à Washington et à Prague, a permis des négociations commerciales qui ont abouti en mai à la grâce et à la libération d’Oatis, mais pas de ses collègues.
Soixante-douze ans après le procès d’Oatis, le Service fédéral de sécurité (FSB), successeur via le KGB du MGB de Staline, a arrêté un homme de 31 ans le journal Wall Street correspondant Evan Gershkovich. Gershkovich est devenu le premier correspondant américain arrêté par les Russes comme espion présumé depuis la fin de la guerre froide. Dans une reprise de l’affaire Oatis, les accusations portées contre lui ne décrivent pas de l’espionnage, mais du journalisme de base. Le FSB se vantait: « Il a été établi qu’E. Gershkovich, agissant sur mission du côté américain, avait collecté des informations constituant un secret d’État sur les activités de l’une des entreprises du complexe militaro-industriel russe. »
Qu’avait-il fait ? Premièrement, il a agi comme n’importe quel autre journaliste pour connaître le nombre de victimes qui revenaient du front ukrainien : il s’est rendu dans les hôpitaux. Ayant moi-même couvert de nombreuses guerres, je peux attester qu’il s’agit d’une procédure opérationnelle standard. Gershkovich a observé des ambulances militaires russes transportant de nombreux blessés, plus que ce que le gouvernement ne l’admettait, vers des établissements médicaux en Biélorussie. Il a ensuite interrogé des Russes près de la frontière russo-ukrainienne sur leurs craintes de voir la guerre s’étendre. Puis, à Ekaterinbourg, dans les montagnes de l’Oural, il a sondé l’opinion publique sur les mercenaires du groupe Wagner. Encore une fois, du bon journalisme à l’ancienne. C’est à Ekaterinbourg, le 29 mars 2023, que le FSB l’a arrêté. Depuis, il est derrière les barreaux à Moscou.
La police secrète du grandiose siège du FSB à Loubianka – où ses prédécesseurs ont torturé et assassiné des générations de suspects – doit considérer les reportages de Gershkovich comme un défi à leur récit des événements. Gershkovich n’espionnait pas, mais il contrariait les espions.
Les poursuites contre Gershkovich avaient un précédent, non seulement parmi les prédécesseurs de Vladimir Poutine remontant à l’époque tsariste, mais aussi dans les actions de l’administration Biden. Ben Wizner, de l’Union américaine des libertés civiles (ACLU), avait déjà prévenu que les poursuites américaines contre WikiLeaks Le fondateur Julian Assange donnerait l’exemple aux autres : « Si les États-Unis peuvent poursuivre un éditeur étranger pour avoir violé nos lois sur le secret, rien n’empêche la Chine ou la Russie de faire de même. » Poursuivre Gershkovich s’inscrit parfaitement dans l’héritage des procès-spectacles staliniens qui ont mis William Oatis au banc des accusés. Cette tradition à elle seule justifie apparemment le traitement réservé par le gouvernement américain à Julian Assange.
L’acte d’accusation américain contre Assange pour 18 violations de la loi sur l’espionnage de 1917 fait étrangement écho aux accusations portées contre Oatis. Alors que la police secrète de St.B accusait Oatis d’avoir révélé « des informations qui devraient rester secrètes », le ministère américain de la Justice (DOJ) allègue qu’Assange a obtenu et divulgué « des informations qui ont été déterminées par le gouvernement américain… comme nécessitant une protection contre des attaques non autorisées ». divulgation. » Dans les deux cas, la réputation du gouvernement était en jeu plutôt que la sécurité de l’État. Pour prendre un exemple, lorsqu’un équipage d’hélicoptère Apache a tiré sur une foule à Bagdad le 12 juillet 2007, le Pentagone a affirmé avoir tué une douzaine de terroristes. Parmi les soi-disant terroristes se trouvaient deux Iraquiens Reuters journalistes. Alors que la plupart des médias ont accepté le récit de l’armée au pied de la lettre, quelques-uns ont exigé l’accès aux enregistrements vidéo de l’Apache. Le Pentagone a rejeté les demandes d’enregistrement des images en vertu de la Freedom of Information Act, et là, l’histoire aurait pu mourir. Mais Chelsea Manning a divulgué la vidéo connue sous le nom de « Collatéral Murder » et WikiLeaks l’a montré au monde.
La caméra de l’Apache n’a montré aucun insurgé au sol, mais l’équipage a tiré sur la foule en contrebas. L’un des membres de l’équipage a plaisanté : « Ha, ha, je les ai frappés. » Son collègue a répondu : « Oh ouais, regarde ces salauds morts. » Ils ont ensuite tiré sur un civil blessé alors qu’il rampait vers un véhicule de secours. En apprenant que deux des victimes étaient des enfants, l’un des membres de l’équipage a déclaré : « Eh bien, c’est de leur faute s’ils ont amené leurs enfants à la bataille. »
Les documents écrits que Manning a fournis à Assange ont encore miné le récit américain de ses actions en Irak, en Afghanistan et dans la « guerre contre le terrorisme » plus large. Malgré leurs dénégations, les États-Unis ont « rendu » – « kidnappé », dans un langage non gouvernemental – des hommes sur la base de preuves douteuses et les ont traînés vers d’autres pays pour y être torturés. Les régimes conformes comme ceux de l’Égypte et de la Roumanie étaient mieux à même de cacher la torture que des pays comme la Suède et le Canada, où la torture était illégale et d’où les suspects étaient « rendus ».
Il a maltraité les détenus de Guantanamo. Cela a violé le « droit du peuple à la sécurité de sa personne, de son domicile, de ses papiers et de ses effets, énoncé dans la Constitution américaine, contre les perquisitions et saisies abusives ». WikiLeaks ne menaçait la sécurité de personne, mais il alertait le public et le Congrès des dangers d’un abus de pouvoir illimité. Cela a également aidé les historiens et autres journalistes à donner une image plus précise de notre époque.
Le DOJ a ajouté une accusation de « complot » contre Assange pour avoir tenté de « dissimuler Manning comme source de documents classifiés ». Conspiration? Quel journaliste révèle ses sources ? William Oatis a rappelé à ses interrogateurs : « C’est contraire à l’éthique du journalisme. » Le Département d’État a condamné la Tchécoslovaquie en 1951 pour avoir traité « toutes les routines normales de collecte d’informations d’un journaliste » comme de l’espionnage. En 2023, ils exigent l’extradition d’Assange vers les États-Unis pour y être jugé comme espion pour avoir recueilli des informations. Se peut-il que le Département d’État, comme il a accusé le régime de Prague en 1951, « ait peur de la vérité, déteste la liberté et ne connaisse pas la justice » ?
La question qui unit Oatis, Gershkovich et Assange n’est pas seulement la poursuite des journalistes pour avoir fait leur travail. C’est une censure de tout ce que l’État estime que nous n’avons pas le droit de savoir. La censure de l’État et de l’Église a fait davantage pour priver l’humanité de connaissances et freiner la créativité que toute autre méthode de contrôle. Savoir que la prison vous attend si vous dénoncez des crimes d’État aux États-Unis ou des mensonges de propagande à Moscou a un effet inhibiteur. De nombreux journalistes ne prendront pas de risque, voire ne le prendront pas.
Le romancier Hani al-Rahib m’expliquait en 1987 comment cela fonctionnait dans son pays, la Syrie : « Le régime est convaincu qu’en chacun de nous se trouve ce policier nécessaire qui travaille pour le gouvernement et s’autocensure sans interférence du gouvernement. Nous avons été terrorisés et poussés à faire grandir ce policier en nous.
L’historienne Erin Maglaque a écrit comment des siècles de censure catholique dans l’Europe moderne ont engendré l’autocensure, déplorant « l’art et la littérature qui n’ont jamais été créés, les idées religieuses et scientifiques qui sont restées non écrites – voire même impensées – en raison de l’existence de l’Index. (des livres interdits), la congrégation (de la foi) et le tribunal de l’Inquisition. La police secrète de Staline, et son incarnation contemporaine dans le Service fédéral de sécurité russe et l’État de sécurité nationale américain, s’inscrivent dans la tradition inquisitoriale consistant à décider ce que vous et moi pouvons (et ne pouvons pas) lire et donc savoir. C’est pour cela que Gershkovich et Assange souffrent l’angoisse de l’isolement dans leurs cachots.